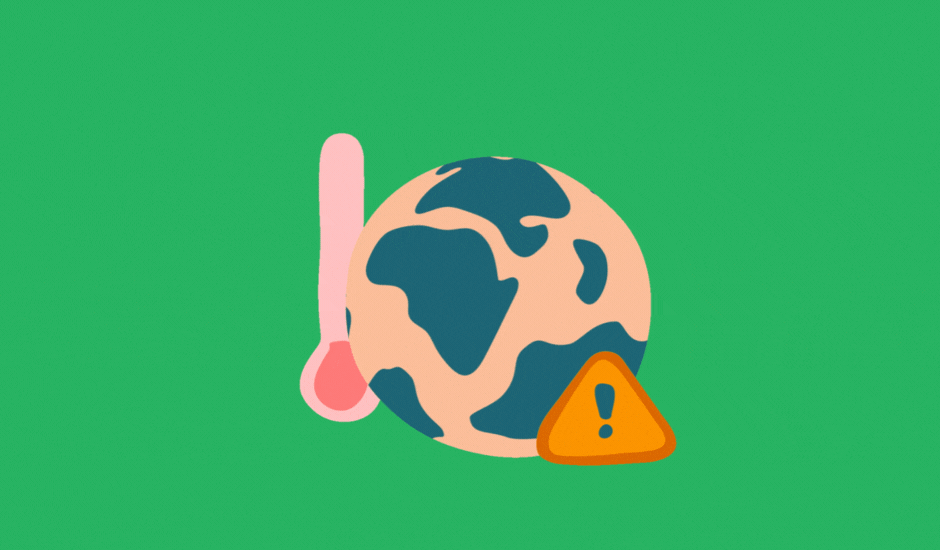| Conseil métropolitain du 2/10/2025Intervention portée par Morvan Le Gentil au nom des élu·e·s écologistes et citoyen·ne·s sur la délibération n°3 – M. Dehaese O. : Développement durable du territoire – Plan Climat Air Énergie Territorial 2025-2030 – Adoption |
63 000. Ce sont le nombre de décès attribués aux fortes chaleurs en 2024 en Europe, continent qui se réchauffe le plus vite. Dans un rapport publié en mars, les experts de Météo France avancent que des pics de chaleur à 47 °C pourraient être atteints dès 2030 sur notre territoire. Nos villes, nos territoires, doivent prendre la mesure de ce constat.
Pourtant, dans un contexte politique national et international complexe et incertain, l’écologie est reléguée au second plan. 2025 est l’année des reculs en la matière : projet de loi Duplomb, suspension du dispositif Ma Prim’Rénov, remise en cause des Zones à Faibles Émissions, assouplissement du Zéro Artificialisation Nette … En tout, 43 mesures ont été prises cette année contre la protection de l’environnement et de la santé des français·es. Pourtant, les questions climatiques demeurent centrales pour la majorité des habitant·es : une étude de l’institut Odoxa indique que 77% des français·es en attendent plus de leurs municipalités sur la lutte contre le changement climatique tandis que 3 français·es sur 10 se disent prêt·es à déménager pour des questions climatiques. Les français, contrairement au bruit de fond entretenus sur les réseaux sociaux, ne sont pas climatosceptiques.
Le contexte actuel nous oblige, et le PCAET que nous votons ce soir revêt donc une importance toute particulière. Boussole du territoire, ce plan doit nous guider : pour réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, adapter nos bâtiments et nos aménagements à un territoire qui se réchauffe, nous accompagner vers l’autonomie énergétique.
Un PCAET pour s’adapter à la réalité
Afin d’adapter notre territoire à la nouvelle donne climatique et agir au mieux, nous devons comprendre ses forces et ses faiblesses. C’est pourquoi nous soulignons la qualité du diagnostic de vulnérabilité qui compose ce nouveau PCAET. On se souvient des fortes inondations qui nous ont touchées en début d’année. Nous devons désormais être prêts à faire face à de type d’aléas.
L’adaptation au changement climatique passe aussi par une meilleure autonomie alimentaire et donc par la préservation de la ressource en eau, tant en quantité qu’en qualité. Nous en profitons pour appeler les métropolitaines et les métropolitains à participer à la consultation publique portant sur la révision du SAGE Vilaine entre mi Octobre et mi Novembre. Il faut défendre une des avancées du nouveau SAGE, à savoir l’interdiction des herbicides maïs sur les zones prioritaires des captages d’eau potables. A l’image de la mobilisation citoyenne estivale contre la loi Duplomb, nous soutenons l’idée d’une grande campagne citoyenne sur notre territoire pour défendre la qualité de l’eau.
Mais si l’adaptation est au cœur du projet, nous ne devons pas renoncer à redoubler d’efforts pour réduire tant que possible notre impact sur le changement climatique. Il faut saluer l’ambition du plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 43% d’ici 2030, là où la Stratégie nationale bas carbone prévoit seulement 37%. Pour y parvenir, des solutions existent : végétalisation, rénovation bioclimatique, agroécologie ou encore infrastructures cyclables. Rennes Métropole les met déjà en œuvre, nous devons poursuivre et amplifier ces actions.
Vers une planification énergétique
C’est également en termes de planification énergétique que nous pouvons noter une véritable avancée. Les écologistes avaient demandé la mise en place d’un plan de déploiement des énergies renouvelables sur notre territoire. C’est désormais lancé, avec la création du Schéma Directeur des Énergies, outil indispensable à l’atteinte de nos objectifs de production. Cette innovation permettra également de définir les modes de production d’énergie que nous souhaitons et l’implication des citoyens et des entreprises dans cette dynamique devra être particulièrement travaillée. Il faudra rappeler dans ce schéma que l’accélération énergétique ne se fera pas au détriment de la biodiversité, ni de notre autonomie alimentaire : un cadre exigeant sera à construire ensemble pour le développement de l’agrivoltaïsme et de la méthanisation, en cohérence et en lien étroit avec les travaux du SDE.
Au-delà de la production, notre Plan Climat doit pouvoir assumer le fait d’interroger les consommations énergétiques. Nous devons tendre vers plus de sobriété, en interrogeant d’abord les plus gros consommateurs. C’est pourquoi au nom des élu·es écologistes, nous avons défendu le lancement d’une étude juridique pour pouvoir interdire l’installation sur notre territoire des serres chauffées agricoles. Destinées à la production de fruits et légumes hors saison, elles sont extrêmement gourmandes en énergie, en représentant la consommation de près de 80 000 foyers.
Pour une économie alignée avec l’écologie
Il est également nécessaire de repenser notre politique économique et industrielle, en interrogeant la finalité des productions que nous soutenons. Les aides de notre collectivité doivent être repensées : privilégions des appels à projets ciblés et centrés sur les secteurs prioritaires de la transition, notamment à destination des PME du territoire. Et acceptons de renoncer à financer ou à faciliter des projets dont les process mais aussi les produits seraient incompatibles avec nos objectifs climatiques.
Ce nouveau PCAET promet d’accompagner au changement. Face aux enjeux climatiques et à la raréfaction des ressources, il est de notre responsabilité de ne pas seulement consommer mieux mais aussi de consommer moins. Cela implique d’encourager la déconsommation et de valoriser toutes les pratiques de réparation et de réemploi, en cohérence avec notre feuille de route sur l’économie circulaire. Une telle stratégie doit également reposer sur un principe de justice sociale, ciblant par exemple les ménages les plus aisés et ayant une empreinte écologique plus marquée. Pourquoi ne pas aller vers la création d’un véritable service public d’accompagnement au changement de comportement, en partant des actions déjà mises en place par l’ALEC, de la Maison de la Consommation et de l’Environnement et le monde de la recherche ?
Suivi, démocratie et équité : les piliers d’une transition réussie
Pour réussir le défi de la transition, ce nouveau PCAET doit embarquer tout le territoire. Dans ce cadre-là, le recours au chemin démocratique nous apparaît incontournable. La mise en place d’une « Assemblée climat », pérenniserait la Fabrique Citoyenne permettrait un suivi citoyen de nos initiatives et donnerait un cadre pour faire émerger de nouvelles propositions.
Nous le répétons : le PCAET doit être le lieu de convergence de toutes nos politiques publiques. C’est pourquoi nous en appelons à la création d’un véritable outil de suivi du plan, sur la base d’indicateurs précis, vu non pas comme une batterie de reporting supplémentaire, mais comme une matrice transversale, partagée avec les divers services concernés, qui serve à la fois pour le suivi de leurs actions, pour alimenter de façon homogène nos rapports d’activité des années à venir, ou pour permettre à la société civile de suivre l’impact de nos politiques. Le PCAET peut ainsi créer la langue commune des différentes parties prenantes autour des transitions.
Nous insistons en outre sur la nécessité d’avoir des indicateurs budgétaires pour les différents objectifs et actions du PCAET. Au moins pour les actions les plus emblématiques, les changements de braquet, les ruptures, il s’agit de faire apparaître de manière transparente les lignes budgétaires en jeu, et quand cela est nécessaire, de mettre en évidence les enveloppes de l’État, des collectivités ou des acteurs privés nécessaires à l’action présentée. Qu’on se le dise : sans choc budgétaire, il n’y aura pas de transition écologique et sociale. Chaque euro public doit servir la transition et nous devons aussi oser poser la question d’une véritable fiscalité écologique, notamment pour soutenir les collectivités en première ligne.
Pour conclure, alors que les reculs climatiques s’enchaînent au niveau national et que les gouvernements climatosceptiques se multiplient à l’échelle internationale, nous ne devons pas céder au renoncement collectif contre le dérèglement climatique. Aujourd’hui, non seulement notre collectivité ne renonce pas, mais elle adapte et prépare notre territoire à faire face. Le débat actuel sur les questions écologiques n’est pas à la hauteur et les voix pour le climat sont à peine audibles ou caricaturées. Avec ce plan, montrons une autre voie : celle d’une action concrète qui transforme le quotidien et anticipe l’avenir. Nous le devons à nos enfants et aux plus fragiles de notre territoire.
Seul le prononcé fait foi